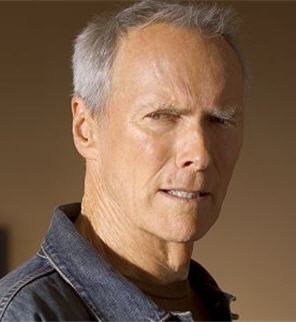Au troisième... euh... deuxième top on sera en... Oh! Et puis merde!
Trop compliquéééé....
Troisième top mais comme le top musical est resté calé sur le blog de Sport Doen ça fait plus que deux mais si on compte le "Spécial Bifff"...
Oooouuuhhh!!!! Mal ma tête!
Bref, le Top 20 de les Meilleurs Films vus (en salle) en 2007 se présente comme suit...
1. "Les Promesses de l'Ombre" (Eastern Promises) de David Cronenberg (CAN).
2. "L'Assassinat de Jesses James par le lâche Robert Ford" (The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford) d'Andrew Dominik (USA).
3. "Zodiac" de David Fincher (USA).
4. "La Nuit Nous Appartient" (We Own the Night) de James Gray (USA).
5. "American Gangster" de Ridley Scott (USA).
6. "La Môme" d'Olivier Dahan (F).
7. "Le Scaphandre et le Papillon" de Julian Schnabel (F).
8. "Le Dernier Roi d'Ecosse" (The Last King of Scotland) de Kevin MacDonald (UK).
9. "My Blueberry Nights" de Wong Kar-wai (HK/USA/F).
10. "Inland Empire" de David Lynch (USA).
11. "The Host" (Gweomul) de Bong Joon-ho (SK).
12. "Boulevard de la Mort" (Death Proof) de Quentin Tarantino (USA).
13. "Chronique d'un Scandale" (Notes on a Scandal) de Richard Eyre (UK).
14. "La Vie des Autres" (Das Leben der Anderen) de Florian Henckel von Donnersmarck (G).
15. "Lady Chatterley"de Pascale Ferran (F).
16. "Raisons d'Etat" (The Good Shepherd) de Robert De Niro (USA).
17. "Le Prestige" (The Prestige) de Christopher Nolan (USA).
18. "Michael Clayton" de Tony Gilroy (USA).
19. "Hot Fuzz" d'Edgar Wright (UK).
20. "Planète Terreur" (Planet Terror) de Robert Rodriguez (USA).
-Meilleurs Acteurs 2007:
Forest Whitaker (Le Dernier Roi d'Ecosse).
Marion Cotillard (La Môme).
Casey Affleck (L'Assassinat de Jesse James...).
...et bien entendu Cate Blanchett pour l'ensemble de son oeuvre!
-Plus Mauvais Acteur du Millénaire:
Mais comment fait-il?
Smaïn, bien entendu!
-Top 1 du Meilleur Film du Monde de l'Univers Connu et Inconnu, Visible et Invisible vu* en DVD:
1. "Je vais bien, ne t'en fais pas" de Philippe Lioret (F).
-Attentes pour 2008:
En vrac et sans vraiment réfléchir:
"Shutter Island" de Martin Scorsese; "The Happening" de M. Night Shyamalan; "La Clef" de Guillaume Nicloux; "It's a free world" de Ken Loach; "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen; "The Dark Knight" de Christopher Nolan; "The Lovely Bones" de Peter Jackson; "Into the Wild" de Sean Penn; "No Country for Old Men" des frères Coen; "Dante 01" de Marc Caro; "Lust, Caution" d'Ang Lee et bien sûr "Sweeney Todd" de Tim Burton, entre autres...
Voilà, cette fois c'est bien fini (pour 2007). Et bonané à tous!
PS: la critique de "Gone Baby Gone" de Ben Affleck, dernier film vu en 2007, attendra le début 2008.
La flemme...
* ouais, ouais...